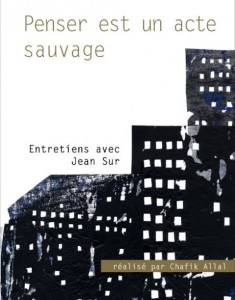LE MARCHÉ V
Retour à Paris. On n’est pas des anges : d’abord le super. Comme d’habitude, pour déconcerter l’adversaire, c’est-à-dire le client, ils ont tout changé. Pas moyen de trouver les salades. Je demande à un grand gaillard vêtu de bleu s’il est du rayon. Il prend un air offensé. Non, il n’est pas vraiment du rayon : il est du magasin. Il me laisse le temps d’apprécier la différence puis, le coude sur un chariot de haricots, consent à m’expliquer. Le magasin, c’est un navire. Je ne suis donc jamais monté sur un navire ? Tout le monde y est solidaire. Pareil dans le magasin. Surtout, à notre époque, où c’est dur pour le commerce. Ce qu’il faut que je comprenne bien, c’est qu’il y a deux catégories dans l’équipage, aussi importantes l’une que l’autre pour la vie du navire. Les matelots à poste fixe, et les autres, disons… disons les mousses. Lui, il est un mousse, il fait ce qu’on lui dit, il va où on l’envoie, il est au service du capitaine. Bonne journée, Monsieur.
Ξ
Si seulement il se moquait de moi ! Hélas ! Il répète ce qu’on lui a raconté en formation. Le pauvre ! Ce qui lui arrive est bien plus grave que de suer sang et eau devant une chaudière. Ou de faire les quatre-vingts heures. Ou de fournir leurs bouquins à tous les Zola du monde. À tout cela on peut encore remédier par la révolte, l’espoir, la lutte. Au mousse du super, en revanche, il est arrivé l’irrémédiable : il s’est lui-même interdit de souffrance, de révolte, de cri. Comment oserait-on se plaindre quand on fait partie de l’équipage du paquebot Le Super qui fonce, de toutes ses machines, sur l’océan du Progrès infini, vers le Paradis du Cac 40 ? On a mis à portée des angoisses et des colères de cet homme, en manière d’extincteur, un délire d’aventures qui, tant qu’on ne l’aura pas licencié, le protégera de tout, lui cachera tout, lui traduira tout. Licencié, il pourra encore se raconter que, dans l’intérêt général, le capitaine doit parfois avoir le courage d’abandonner au port, le cœur déchiré, quelques-uns de ses meilleurs matelots.
Ξ
Plus naïf que la moyenne, ce mousse ? Peut-être. Mais, par là, superbe révélateur de l’escroquerie au rêve qui est la spécialité de toute une partie de ce qu’on appelle encore la « formation ». Son rôle ? Mettre ce qui reste dans les travailleurs d’enfance, de timidité, de gentillesse native, de docilité, au service de l’avidité du cynisme général et des quelques insuffisants existentiels qui l’organisent. Il n’est pas vrai qu’il n’y ait rien à faire. On peut tout faire et tout de suite. On le peut en toute légalité, en tout esprit démocratique, en toute droiture. Si le monde économique est le centre vital de l’aberration moderne, si les entreprises sont le centre vital du monde économique, si la propagande managériale est le centre vital des entreprises, c’est là qu’il faut atteindre la bête. Par quelles armes ? La parole, le vocabulaire, le courage de nommer, l’invention drolatique. Rien d’autre, mais, cela, jusqu’au bout.
Ξ
On nous impose la propagande ? Cassons la propagande. Est-il crapuleux, oui ou non, le personnage qui a inventé cette histoire de navire ? Alors cette mystification doit être traitée pour ce qu’elle est. Il faut inventer un contre-langage qui la donne à voir. Par exemple : « Tu fais quoi la semaine prochaine ? » – « Je vais en formation. » – « Formation de quoi ? » – « De crapulerie. » Pas besoin de charger la barque à l’excès. L’animateur d’une crapulerie n’est pas forcément une crapule. On peut inventer un mot moins méchant, presque indulgent : crapulard irait bien. Nommer, ce n’est pas toujours faire changer, mais, ici, Sartre a raison : nommer la manipulation, c’est lui porter un sacré coup.
Ξ
Mettre systématiquement les salariés devant le libre choix. À eux de savoir, par exemple, si le mousse du super a bénéficié d’une session de communication ou s’il a subi une agression crapuleuse, un viol intellectuel. Pour qu’ils répondent à la question, encore faut-il qu’elle leur soit posée. Qu’attendez-vous, camarades syndiqués, pour porter le combat sur ce terrain-là ? Les autres aspects de la lutte en profiteraient. N’êtes-vous pas d’accord avec cet objectif très simple, très paisible, j’allais dire très français : aider les gens à employer les mots qui correspondent à ce qu’ils sentent, déblayer au maximum les bavardages meurtriers ? S’il faut à tout prix que le super devienne le paquebot Le Super, alors qu’il soit clair pour tout l’équipage, y compris pour le commandant, qu’il ne cinglera jamais que sur l’océan de la Connerie.
Ξ
Reconstituer une sensibilité sociale moins tordue, ce n’est pas un beau programme ? Quoi, vous ricanez ? Vous dites que le poids de la réalité est bien plus lourd que je ne l’imagine ? Ah! chers spécialistes de la pesanteur, comme elle vous colle le cul sur votre chaise aux normes syndicales, votre réalité ! Comme elle vous renvoie dans l’arrière-gorge toute parole un peu hardie qui voudrait aller prendre le frais dehors ! Comme ils vous embrument l’esprit, les psychotrucs et les sociomachins, ces cache-sexe de votre exquise délicatesse (privée) à l’égard des puissants ! Dire que vous allez me trouver intolérant, vous qui ne tolérez que votre paresse ! Comprenez-vous ? Ce que vous appelez le poids de la réalité, c’est la monotone, c’est l’inépuisable répétition de vos hésitations. Auriez-vous secrètement besoin, vous aussi, qu’un chat ne s’appelle pas un chat ?
Ξ
Ça commençait sec, l’année… Pourtant, au retour du Beaujolais, une courte halte à Sens avait été bien plus sereine. Il y avait concert d’orgue dans l’admirable cathédrale, et une exposition sur le vitrail qui représente l’histoire évangélique du fils prodigue parti bouffer sa part d’héritage « avec des filles » en laissant tomber son vieux père ; mais le père, quand son grand gamin revient, fait la plus belle fête de sa vie, enfile ses jeans les mieux troués et tue le veau gras sans hormones ; alors le frangin du fils prodigue, le gars sérieux, celui qui n’a rien loupé de ses devoirs, se met à faire la gueule ; et le père l’avertit qu’il n’a que peu de temps pour comprendre, que c’en est fini des comptes, et des calculs, et des vertus, que le climat du cœur a changé, qu’il peut se mettre son management où il veut. Et des beaux textes, sur les murs de la cathédrale, expliquent que le péché originel, ça doit se lire à l’envers, que le départ, c’est le pardon originel, le grand filet de l’amour où les petites sardines que nous sommes, à la fois créées et libres, donc forcément imparfaites, sont invitées à venir frétiller.
Ξ
Bien sûr que c’est vrai tout ça, c’est même plus vrai que le vrai ! Mais alors, mon super, qu’est-ce qu’il fabrique là-dedans ? Pourquoi toutes ces vies dominées par la bouffe des autres ? Pourquoi ce pauvre mousse intoxiqué ? Qu’est-ce qui peut sauver un super ? L’affabilité publique ? Porter le sac des vieilles dames, sourire aux caissières ? Un peu court, non ? Naguère des illuminés voulaient y installer des centres de méditation. Pourquoi pas des pédicures, des psychiatres, des bordels, des montreurs d’ours ? Les gens du super m’importent, pas le super. Rien à faire pour un super ; contre, non plus. C’est un déchet socio-culturel, comme on parle d’un déchet nucléaire. Rien ne mord sur un super, signe majeur de notre société. C’est du pratico-inerte organisé, cristallisé, du concret sans références, sans abstraction possible, c’est-à-dire du néant à l’état pur. Voilà pourquoi notre mousse avale tout ce qu’on lui raconte : trente-cinq heures de néant, c’est insupportable. Personne n’est taillé pour vivre dans le rien, comme un ermite à l’envers immergé malgré soi dans la matière.
Ξ
Extraordinaires vendanges, cette année, dans le Beaujolais. De mémoire de vigneron, les plus précoces et, du point de vue de la quantité, les plus décevantes : la canicule, ajoutée à la grêle, au gel, au vent, au caprice de la nature, en a décidé ainsi. Mais le vin sera bon, bien sûr, très bon. Étrange comme cette crise, pénible pour tous, désastreuse pour certains, est une occasion, presque heureuse, de parler. Car, pour une crise, c’en était une : le vin, les saisons, l’avenir, tout semblait péter comme un bouchon sur une bouteille de paradis. Le village était en état d’expression. Et puis, les vendangeurs ne sont plus ce qu’ils étaient ; alors les commerçants se protègent. Mon ami Ettore Gelpi, qui nous a quittés l’an dernier, expliquait toujours que le caractère chinois qui désigne la crise est fait de deux caractères, l’un qui signifie chance, l’autre danger. Le danger qu’a couru le fils prodigue lui est devenu une chance ; la chance du fils vertueux lui est devenue un danger. Méfions-nous de ceux qui veulent nous éviter les crises : ils consolident leur pouvoir. L’autre avantage du Beaujolais, c’est que les vignerons ne suivent pas de formation au management ; ils parlent donc encore selon leur langue, selon leur esprit, selon leur cœur. On est bien avec eux.
Ξ
La jeunesse américaine qui s’interroge sur la triste aventure irakienne devrait méditer sur deux citations d’auteurs français du XXe siècle. La première est tirée d’un rapport présenté à l’Administration coloniale, en 1947, par Jacques Berque, alors en poste au Maroc, rapport qui lui valut d’être expédié dans le Haut Atlas : « Le vrai ordre ici serait que nous n’y fussions pas. » La deuxième citation est d’Aragon. Elle parle d’un gentilhomme parti pour la guerre, et qui n’en revint pas, comme hélas! beaucoup de jeunes Américains emportés dans la tourmente avec ceux qu’ils croyaient devoir combattre :
Jean de Schelandre est mort à Saumazènes
D’une blessure à la guerre qu’il eut
Naguère allant sous Monsieur de Turenne
Porter la France ailleurs qu’il eût fallu
Ξ
Et la jeunesse française ? Une fille raconte à la télé qu’elle vient de passer le bac. Que l’épreuve était difficile ; que l’année, en gros, a été mauvaise, mais qu’elle a réfléchi sur sa vie. Elle dit qu’elle a envie de faire autre chose que l’école, et, comme cela, de se « casser la gueule » et de pouvoir se dire que l’école, c’était mieux. L’école comme pis aller, comme roue de secours, comme protection contre soi. Que dire ? Que plutôt que réfléchir sur sa vie, il vaut mieux laisser sa vie se réfléchir en soi ? Formules, formules…
Ξ
Quand même, il faut se poser la question. Qu’est-ce que je dirais à un jeune ? Allez, je me mets moi-même au défi. S’il faut vraiment répondre, ceci : « Accueille de tout ton cœur l’à venir. Sur ce qu’ils appellent tous ton avenir, tire la chasse. »
(15 septembre 2003)