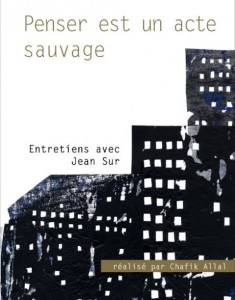Avant de dire pourquoi j’ai décidé de créer ce site, je souhaite expliquer dans quelles circonstances l’idée m’est venue de le faire.
Je n’y aurais probablement pas pensé si j’avais pu continuer à publier. Mais, après quatorze livres et une grosse centaine d’articles, l’édition et la presse semblent me fermer leurs portes.
Cette mise à l’écart peut faire planer sur mon projet un soupçon de dépit qui m’aurait peut-être poussé à y renoncer si je n’avais fait qu’écrire des livres. L’âge, un peu de découragement, le sentiment de l’inutilité, la conscience du ridicule qui s’attache à une obstination vaniteuse, la certitude de ne pas être un prophète dont le silence priverait l’humanité d’une révélation décisive, tout aurait plaidé pour l’abstention. Mais mon activité principale a été la formation des adultes, non pas l’écriture ; les trente années que j’ai consacrées à ce travail me conseillent, elles, de tenter l’aventure.
Elles furent loin d’être idylliques. Mes rapports avec les dirigeants des entreprises furent constamment marqués de méfiance et, presque toujours, d’hostilité. Les syndicats me firent parfois un accueil prudemment poli ; nous ne nous cherchions guère. J’ai bénéficié d’une seule approbation, apparemment négligeable aux yeux des diverses formes de nomenklatura : celle des travailleurs. Je m’étais mis en tête d’être le champion d’une idée unique, mais de la défendre avec un acharnement intransigeant : l’urgence, pour les salariés, grands et petits, c’est de se guérir de la lourde carence d’expression dans laquelle on les maintient et où, souvent, ils se complaisent. Propos – en très gros – socratique, que j’ai choisi délibérément, qui ne m’a pas encore valu de boire la ciguë, mais qui m’a constamment placé en position délicate vis-à-vis de toutes les autorités et de la plupart de mes collègues.
Les rencontres que je dois à la formation portaient une belle charge de réalité, de vérité, de simplicité ; elles puisaient loin dans notre imaginaire et produisaient souvent une poésie inattendue dont je me reproche de n’avoir pas gardé la trace. Les participants appréciaient ces séances, et je les appréciais moi-même autant et plus qu’eux. Je n’y développais pas des analyses très originales, je n’y mettais en œuvre aucune méthode révolutionnaire. J’essayais seulement de favoriser la parole simple et gratuite, celle qui, négligeant les confidences oiseuses comme l’assommant inventaire des opinions, descend, telle une foreuse, dans les profondeurs de l’être. Ma motivation première ne m’a jamais échappé : mon immense besoin de relations de ce genre. Je voyais bien que j’apportais à cette tâche plus de demandes et de questions que d’offres et de réponses, mais cela n’avait rien de décourageant puisque, à chaque séance, la preuve m’était administrée que je n’étais pas le seul à souhaiter ces échanges-là, et qu’il y avait, dans ce désir partagé, un des liens les plus forts qu’on puisse tisser avec les autres.
Nous parlions moins de nous-mêmes que du monde où nous vivions. Les critiques tombaient dru, mais les plus sévères portaient toujours, comme en creux, l’espoir d’une reconstruction. Cette parole libre qui nous unissait, et qui abattait, comme châteaux de cartes, les édifices prétentieux de l’argent, du pouvoir et de l’image, nous protégeait de tout désespoir : elle était comme une trace anticipatrice, comme un signe laissé par l’avenir. Une imprenable liberté faisait son chemin au milieu des contingences quotidiennes, des tracas et des querelles. Ce fut pour moi comme un long état de grâce de trente ans, qu’épicèrent bien des bagarres et pas mal de soucis. Il m’aurait fallu entièrement stupide, ou singulièrement fat, pour exagérer l’importance de mon rôle. Comme on le voit dans la peinture ancienne, la grâce s’accueille avec un mouvement de recul. Quand je me suis posé la question de ce site, j’ai revécu en pensée plusieurs de ces rencontres. Était-ce de la présomption ? J’ai eu envie de continuer à provoquer cette grâce en prolongeant par l’écrit ce que j’avais entrepris par la parole.
À mon âge, il n’est guère étonnant que je ne sois pas un familier de l’Internet. Je me débrouille assez proprement du traitement de texte ; le reste, cette technique compliquée, ce vocabulaire mystérieux, n’est pas mon affaire. Il a fallu un hasard bienveillant pour me mettre sur les traces du site Périphéries. J’ai rencontré sa jeune animatrice, Mona Chollet. J’ai parlé avec elle, j’ai lu ses textes et son livre (Marchands et citoyens, la guerre de l’Internet, Nantes, Éditions L’Atalante). Elle m’a convaincu : quelque chose est possible sur Internet.
Par vieille habitude, je me suis demandé d’où j’allais parler. Et pour dire quoi ? Ce que je pense de la vie et du monde ? Alors, pourquoi pas six milliards de sites ? À propos, quand je faisais le formateur, je parlais d’où ? De la nécessité de gagner ma vie ? De ma peur du temps qui passe ? De mon désir de jouer un rôle qui me donne une bonne idée de moi-même ? Tout cela, bien sûr, comme tout le monde ! Mais après ? Ou plutôt : mais avant ? D’où ai-je tiré ce que j’ai raconté pendant trente ans, moi qui ne suis pas un puits de science ?
Je reviendrai sur la question. Car il y a un préalable. Ersatz de formation ou substitut d’édition, ce site passe par l’écriture. Il la faut aussi docile que possible au dessein que je poursuis : à projet nouveau, forme nouvelle. Je dois donc me poser la question de mon écriture.
Ne serait-ce pas plutôt celle de mes relations avec les éditeurs ? Je me suis toujours senti à l’aise dans la correspondance, presque aussi à l’aise qu’à l’oral. Mais écrire en vue de la publication m’a constamment été pénible, sans que le temps n’arrange rien. Toujours la même difficulté : je sens que je m’y endimanche, et donc que je me limite, m’isole, me stérilise. La peur de ne pas dire assez, ou assez bien, me pousse à resserrer, à l’excès, la pensée et l’expression. Si, au contraire, je cherche à baisser la pression, le résultat est détestable, et je déchire tout. Je me sens tiraillé entre un style trop soutenu, trop tendu, et une manière trop facile, que je rejette. J’ai du mal à me tenir à ma propre hauteur ; je me juche trop haut ou me laisse tomber trop bas.
Je me rappelle une conversation avec un de mes éditeurs, dans les années 60. Il m’avait dit avoir apprécié mon premier roman mais il m’incitait à plus de fluidité. « Trop de tension, m’avait-il expliqué. Sentez-vous donc libre ! » Il me révélait ainsi la nature de ma difficulté mais, loin de m’aider à la surmonter, il l’aggravait. Que celui de qui dépend la publication ou le rejet de votre texte vous invite à la liberté, voilà un cas de double contrainte assez flagrant! Suis-je le seul à connaître cette tentation insidieuse d’écrire, non pas d’abord pour les lecteurs, mais pour le premier et le plus puissant d’entre eux, l’éditeur ?
Au fil du temps, mes difficultés ont changé de nature. Dans les années 60 ou 70, une maison d’édition m’intimidait par l’excellence qu’elle symbolisait : c’est en tremblant que je tendais ma copie à des aréopages qui rassemblaient tant d’esprits pénétrants et distingués. Être agréé par de tels juges me procurait une joie sans mélange ; être refusé par eux, loin d’être ressenti comme une honte, était une saine invitation à l’humilité et au travail. Depuis que les considérations commerciales ont conquis dans l’édition l’importance qu’on sait, j’ai pu faire l’économie d’une bonne partie de cette crainte révérencielle.
Je me suis aperçu de ce changement au début des années 90, quand l’ambition m’est venue d’écrire un livre sur la formation des adultes. Mon métier m’a offert un point de vue exceptionnel sur une société que je n’ai appris à connaître ni dans les ouvrages de sciences humaines, ni dans les abstractions des théoriciens ou des militants de tout poil, mais dans mes conversations avec des centaines, des milliers de travailleurs qui m’ont confié des doutes et des épreuves qui n’avaient que très peu à voir avec ce que rabâchent les gazettes, les partis et les clubs. Je pensais qu’il était utile de témoigner de tout cela. J’écrivis un article que Le Monde publia. Je reçus, peu après, une lettre d’une des responsables d’une grande maison d’édition ; elle m’invitait à prendre contact avec elle pour réfléchir à un ouvrage qui développerait les thèmes de cet article. Nous convînmes d’un rendez-vous. Elle m’y confirma que le sujet l’intéressait. Elle jeta un bref coup d’œil sur mon article, qu’elle avait sur sa table, me tint des propos généraux sur les problèmes de l’édition puis, revenant à notre projet, me répéta que ce livre devait être écrit, m’annonça toute souriante qu’elle allait m’y aider et commença, séance tenante, à en dessiner le contour.
Ce genre d’adhésion vaut agression. Mon projet eût été attaqué au lance-flammes qu’il n’en eût pas été plus parfaitement anéanti. Et avec lui, en puissance, sans que j’ose clairement me l’avouer, l’ensemble de mes relations avec les éditeurs. J’ai publié d’autres livres après cet incident, mais je ne pouvais plus voir mes interlocuteurs du même œil. Je sentais avec tristesse que quelque chose de grave s’était passé, que j’aurais du mal à trouver dans un éditeur le garant exigeant et sévère de la qualité d’une écriture, de la justesse d’une sensibilité, de la loyauté d’une pensée, et qu’il s’agissait désormais de négocier la fabrication d’un produit avec un partenaire habile et, surtout, puissant.
Je ne suis pas le seul à regretter cette évolution. Mais, dans mon cas, l’incident avait poussé la contradiction jusqu’à l’insoutenable. Ce que voulait en effet montrer le livre auquel je songeais, c’était l’écart terrifiant que je n’avais jamais cessé d’explorer entre, d’un côté, la sensibilité des travailleurs, la nature des interrogations qui les traversent, la hiérarchie des valeurs inscrite dans leur cœur et dans leur esprit et, de l’autre, les objectifs qu’on leur propose, la violence quotidienne qu’on leur impose, la propagande dont on les abrutit. J’attendais de l’éditeur, sinon qu’il partage toutes mes vues, du moins qu’il soit sensible au tragique de cette contradiction. Écrire ce livre, ce n’était pas analyser, une fois de plus, les mécanismes de la société de consommation et leur opposer un point de vue noblement humaniste. Je ne pouvais donner idée de ce que ressentaient les travailleurs qu’en me faisant, à mes risques, aussi simple, aussi honnête, aussi périlleusement authentique qu’ils s’étaient montrés à mon égard. Mais, à peine avais-je dit deux mots à mon interlocutrice que mon propos était déjà broyé par une mécanique toute semblable à celle dont je voyais, jour après jour, dans les entreprises, les redoutables progrès. Volontairement ou non, l’éditeur jouait désormais dans le camp de mes adversaires.
Depuis, tout ce que j’ai écrit a dû être deux fois conquis sur la colère. Mon refus explicite de cette société lourdingue, cynique, cruelle, se doublait malgré moi d’une protestation implicite contre le statut du livre auquel je travaillais et, surtout, contre le regard qu’y jetterait l’éditeur. Si courte soit ma pensée, si ordinaires les battements de mon cœur, c’est ce cœur et cette pensée que je jetais dans la balance : en face, on supputerait le profit à venir et les conséquences sur l’image. Échange inégal.
Ce projet Internet a modifié la donne. Les éditeurs ne seraient donc plus pour moi des interlocuteurs obligés ? Quelle révolution ! J’ai revu mes relations avec eux, comme on le fait à la mort d’un ami. Beaucoup de gens remarquables, oui. Et pourtant, depuis toujours, ce malaise où ils me jetaient, et que je n’avais jamais voulu affronter, comme si je m’étais fait une règle de ne pas avoir avec eux de relations conflictuelles, comme si l’univers culturel où ils se déployaient devait les protéger de la contestation… Avais-je tout simplement trop besoin d’eux pour oser ouvrir les yeux ? Je m’avouais pour la première fois que, pour avoir été généralement sereines, mes relations avec eux n’avaient jamais été plus chaleureuses que celles que j’avais entretenues avec les champions du monde économique. J’avais pu constater en quel mépris ces derniers tenaient les travailleurs : leur retourner ce mépris était un mouvement peu glorieux, mais assez naturel. Jeter dans le même panier des gens censés incarner la culture, l’art, la pensée, toutes sortes de choses sublimes, ça, je me l’étais interdit.
Ressentiment métastasé ? Sincèrement, je ne crois pas. Pathologie ? À démontrer ! La réalité me paraît plus simple. Les patrons et les éditeurs sont les deux seules figures de pouvoir que j’aie croisées durant les trente dernières années. Les premiers ne pouvaient affecter que mon activité, mes contrats, mes revenus ; je ne les rencontrais qu’au for externe, comme on disait autrefois. Faire des confidences à un manager, lui exposer sa conception de la vie, c’est obscène ! Les relations avec les éditeurs sont d’un autre ordre. Chaque livre qu’on leur propose est une confidence dont ils sont les premiers destinataires ; ce sont là, même si l’on s’en défend, des relations au for interne. Entrer en conflit avec eux, c’était entrer en conflit avec l’idée que je me faisais de moi.
Ici, sur Internet, rien ne pèse. J’écris à des amis. Connus ? Connaît-on jamais vraiment ? Inconnus ? Ignore-t-on jamais vraiment ? Cette liberté me fait un peu peur. Rien ne doit peser : cela, précisément, pèse. Il faudra renvoyer dos à dos conformisme et anticonformisme, pathos intégré et pathos protestataire. Et tant de choses encore… Je suis tout surpris de m’adresser aux autres directement, directo comme nous disions en jouant aux billes. Aucun filtre, aucun contrôle, personne pour m’expliquer que mon papier n’est pas mal, mais pas très vendable. Et maintenant que vais-je faire ? Vais-je savoir écrire sans canne ? Vais-je pouvoir inventer une forme, une manière, vais-je oser en changer aussi souvent qu’il le faudra ?
Allez savoir pourquoi, je songe à ces épisodes cocasses de la formation où, soudain, surtout lorsque les participants étaient des cadres, un personnage obséquieux faisait son entrée dans notre salle et, affectant une immense confusion, me demandait de libérer un des stagiaires, au motif qu’un haut personnage de l’entreprise le convoquait, toutes affaires cessantes, dans son bureau. Cinéma pour cinéma, je le prenais de très haut et lui faisais savoir que, n’étant pas gardien de prison, je n’avais à libérer personne ; le stagiaire en question ferait comme il voudrait ; mais je priais l’ambassadeur de faire savoir à ce haut personnage qu’il agissait d’une façon non seulement arbitraire, mais encore contraire à la lettre et à l’esprit de la loi qui prévoyait que le travail de ce stagiaire, ce jour-là, était précisément d’être en stage. C’était là, on le voit, un acte d’un assez modeste héroïsme, même si, aux yeux des managers, il n’améliorait guère mon image ! Pourtant, dix minutes après ce minuscule fait d’armes, le climat du groupe s’était entièrement transformé ; tout le monde était devenu plus réfléchi et plus jeune, plus grave et plus joyeux. Pourquoi donc ai-je repensé à ces incidents ? Peut-être pour me rappeler de ne jamais m’enfermer dans un sujet…
Au début des sessions, il en venait de partout, des sujets, tous plus passionnants les uns que les autres, et plus actuels, et plus importants, et plus urgents, et plus ceci, et plus cela. Je ne disais rien. Pas par stratégie ; parce que j’étais incapable de choisir. Mais, à peine sortis de l’œuf, ils disparaissaient ; il ne restait entre nous qu’un silence gêné. Les gens regardaient par la fenêtre, parlaient du temps. Et soudain, né de rien, d’une blague, d’un mot désabusé, d’un soupir, quelque chose s’inventait son chemin dans les esprits et dans les cœurs. Je reprends ma question. Pour parler de quoi, un site ? Au fond, dans parler de quoi, ce n’est pas tellement le quoi qui fait problème, c’est plutôt le de. Chercher un sujet, c’est un peu vouloir taper dans le mille, ça fait naître des idées de missiles. Sensible, professait jadis Bernard Lubat, jamais à court de calembours, c’est sans cible.
Comme c’est curieux d’être ici ! Il ne me déplaît pas qu’Internet soit un lapsus de l’armée américaine, une erreur de la violence. Et voisiner avec un tapis de fantasmes ne me dérange nullement. Si glorieux que fussent les étendards sous lesquels je les ai abrités, je suis fait de fantasmes, pas vous ? Je me rappelle ce professeur de la Sorbonne qui se bouclait à clef avec ses étudiants, en mai 68, pour ne pas être importuné par la vulgarité des temps. Va pour les fantasmes, même si les purs du vice sont aussi zozos que les purs de la vertu ! Pureté de l’intelligence, pureté de la circonstance, pureté de l’intention : que de blagues ! Elles m’occupaient encore dans mes premières années de formation : je ne me sentais pas digne. Qu’est-ce qu’un pauvre bonhomme comme moi, jeté malgré lui dans le monde, et tout occupé à lutter désespérément contre ses passions et son ignorance, pouvait bien avoir à dire à ses semblables ? À moins de leur réciter des bouquins, ce qui, alors, eût été honorable ! Mais parler de soi, parler par soi, quelle idée impudique ! Et puis, une fois devant ces inconnus que je sentais si proches, à peine avais-je sauté dans le vide qu’une espérance tombait du ciel comme une échelle de corde… Preuve irréfutable que nous ne délirions pas, nous trouvions la force et le goût de massacrer joyeusement les mensonges par lesquels on nous asservissait. Quel bonheur de fourbir nos armes, dans cette semi-clandestinité, contre la bête économique devenue folle, et de le faire dans sa propre tanière ! J’aimais à faire claquer le nom de ce beau métier de formateur qui ne rappelait guère à la plupart de mes collègues que les craquements d’une échine trop souvent courbée. Et je rentrais chez moi, et je redevenais le personnage problématique que je ne connaissais que trop. Je prenais le journal ; il me tombait des mains.
Faire passer, si c’était possible, un petit peu de tout ça dans ce site, peut-être que ça ne servirait pas à rien ? J’aimais l’ambiguïté des sessions, cette ferveur sur fond de gris, un peu cruelle. C’était celle de mes poètes préférés, Léon-Paul Fargue en tête, dont j’écoutais avidement la voix sourde, pendant la guerre, à la TSF. Une tendresse un peu sauvage, une amertume puissante. C’était à Montrouge, il y a soixante ans, au groupe d’Habitations à Bon Marché (HBM) de la rue de la Solidarité, là même où, dix ans après moi, naîtrait Coluche. L’appartement est propre, ma mère s’y évertue. Mais passons vite… Entrons par la cuisine dont l’évier est la seule salle de bains, ne nous attendrissons pas sur ces trois pièces gentillettes, traversons la salle à manger, ouvrons la porte-fenêtre et venons-en à mon domaine, à mon royaume, à ma tribune : le balcon.
Il n’y en a que deux sur la façade de ciment qui donne sur la rue Léon-Gambetta. Deux, et nous en avons un! Ce privilège me permet de devenir, à ma guise, orateur haranguant la foule ou commandant contemplant, de la passerelle de son navire, l’océan de la rue que borne l’immeuble d’en face, lui-même dissimulé, l’été, comme les boucles de la gracieuse petite fille du deuxième étage, par le feuillage épais d’un tilleul. En bas, les ménagères, les petits métiers, les ouvriers qui entrent au bistrot en riant ; assez souvent des disputes, des bagarres parfois. Le dimanche, princesse qui s’encanaille en banlieue, une voiture de sport enlève un couple d’amoureux, inatteignable image de la volupté. Il m’arrive de guetter un passant sur le trottoir opposé. Je l’accueille à une extrémité du balcon et l’accompagne lentement, le plus lentement possible, jusqu’à l’autre extrémité, d’où je le regarde s’éloigner.
Je ne souhaite pas évoquer ici des souvenirs, encore moins m’attendrir sur une enfance que je ne pourrais que recomposer et trahir. Je ne roule pas en marche arrière. Je n’ouvre pas ce site pour chercher dans le passé je ne sais quelle consolation à moi seul destinée. Je n’ai aucun goût pour le regard élégant, fatigué et mou que l’adulte un peu revenu des vanités du monde jette sur ses jeunes années. Ce balcon fut ma première et ma meilleure université ; il continue à me dispenser ses leçons. Je ne veux pas prendre mon enfance à contresens. Elle est derrière moi, elle me pousse. Un bref regard sur elle suffit ; tout de suite continuer la route. Ainsi le relayeur qui attend l’arrivée de son camarade, impatient de saisir le témoin pour s’élancer. Dans le rétroviseur de la mémoire, il n’y a que des images. L’enfance, c’est le contraire d’une image, c’est la substance vive du présent ; quand il se détourne d’elle, il perd ses couleurs. Seuls les orgueilleux ne font pas cas de leur enfance : elle les rendrait humbles puisqu’ils ne sont pour rien dans ce qui la constitue. Par quelque biais qu’elle nous ait saisis, souffrance ou plaisir, bonheur ou malheur, elle est un texte à nous seuls confié pour que nous l’interprétions, un message, parfois crypté, pour nous encourager à vivre.
Mes premières années furent solitaires, au moins jusqu’à l’adolescence. Affectivement, socialement, culturellement, linguistiquement décalées. Probablement trop contraintes. Je leur dois une sensibilité en conduite forcée. Mais chaque vie est un crible, chacun de nous un chercheur d’or. De la mienne, beaucoup de choses sont retombées mais les rêveries sur le balcon sont restées : voilà l’affaire. Je leur dois un peu de souffrance ? Qui ne souffre pas ? Du bonheur, aussi ? Pourquoi en faire état ? Quel intérêt pour le lecteur ? Et que cela ait pesé lourd sur ma vie, que je n’aie jamais pu voir sérieusement le monde avec d’autres yeux que ceux de mes dix ou douze ans, à qui cela importe-t-il ? Plus jeune, j’avais besoin, comme tout le monde, d’évoquer ce passé pour y chercher des repères. Maintenant, à quoi bon ?
Mais il y a eu le métier, il y a eu la formation. À écouter tant de gens parler d’eux et du monde, à tâcher de deviner d’où leur viennent leur goût de vivre et leurs maux, j’ai été frappé par les ressemblances bien plus que par les différences. La différence, c’est une manière particulière d’être semblable : c’est dans la communion avec les autres, non pas dans un préalable affiché, qu’elle prend son sens et son éclat, et témoigne de l’unité multiple de la vie. Dans ces moments de grande proximité pudique qu’offraient les sessions, chacun de nous jouissait de sa différence non pas pour s’y enfermer, mais pour le plaisir souverain de la brûler au feu commun. Ma différence, c’était d’avoir subi cette compression, cette mise à distance obligée du monde, de m’être senti, très tôt, ailleurs. Cela m’avait valu quelques embarras mais aussi, je le constatais dans ces séances, quelques clefs. C’est ainsi qu’en ouvrant ce site, j’ai été conduit à réviser les leçons de l’université du balcon comme on fouille sa cave, avant un voyage avec des amis, pour remettre la main sur une gourde, un sac, une lampe de poche qui pourraient d’aventure être utiles à quelqu’un.
Car le balcon m’a dépanné de quelques évidences. C’est un peu absurde de tenter de les exprimer dans mon langage d’aujourd’hui ; plaquer des mots et des idées sur ses impressions d’enfant est un exercice parfaitement arbitraire. Pourtant, même si je mélange ici les sensations brutes de l’enfance et ce qu’elles m’ont inspiré par la suite, je ne crois pas altérer l’essentiel. Nos idées évoluent, nos opinions changent, nos sentiments passent ; nos rêves, nous ne pouvons guère que les repeindre.
Première évidence, ce que je sens, je le sens. C’est en moi comme un poids, mais un poids qui m’allège. Comme une limite, mais qui me donne accès au monde, aux autres, à moi-même. C’est un point de vue qui m’a été attribué, un point de vue vivant, qui est aussi un regard. Tout gamin, je sais que les raisons que je me donnerai de renoncer à ce point de vue seront dérisoires et malhonnêtes, et qu’elles me conduiront, quand même les autres ne s’en apercevraient pas, à une catastrophe méritée. J’avais raison. À chaque fois que j’ai tenté d’échapper à ce regard, le monde a perdu toute réalité ; les êtres les plus familiers me sont devenus plus étrangers que ne l’étaient encore, cinquante ou soixante ans après, notre boulangère tuberculeuse, sa fille Gisèle, les clients accoudés à la buvette de l’épicerie Julien Damoy, les ouvriers qui revenaient de l’usine d’Arcueil.
Autre évidence, la vie du dehors ne ressemble guère à la vie du dedans. Impossible de les réconcilier. Les mots ne servent pas à grand-chose. Ils sont impuissants à créer des liens. Ils ne jettent aucun pont entre le dehors et le dedans. Bêtement, ils désignent, comme l’étiquette plantée dans le reblochon. Au mieux, ils ressemblent aux petits drapeaux que les navires hissent à leur mât pour se saluer. Au pire, ils servent à la comédie de la violence, de la séduction, de la violence de la séduction et de la séduction de la violence. À dix ans, j’ai beau être le contraire d’un enfant martyr, toutes ces pitreries me sont déjà familières. Mes parents sont les premiers managers que j’ai rencontrés. Ils me mettent la pression, cherchent la performance, m’assomment de leurs principes, me décrivent les mille et une traîtrises que me réserve l’avenir. Pour mon bien, toujours pour mon bien !
Ils m’aiment. Moi aussi, bien sûr, mais pas pour ce qu’ils croient, pas pour leur dévouement, pas pour leurs conseils, pas pour le souci qu’ils se font pour mon avenir : tout ça, c’est les conneries qu’on écrit à la Fête des Mères. L’amour, c’est ce qui plaît quand on le voit, id quod visum placet : que puis-je aimer d’eux quand ils se barricadent derrière ce qui leur fait peur ? J’aime mon père quand il joue au billard avec mon oncle, et qu’il gagne. J’aime ma mère quand elle vient me réveiller en chantant à tue-tête l’air de Nabucco. Je les aime par leurs ratés, par leurs marges, par leurs lapsus, par ce qui sourd de vie en eux, malgré eux. Et vive le mensonge, ce merveilleux parachute dont nous fait cadeau la Providence pour nous empêcher de nous fracasser contre la bêtise ! Plus j’ai l’air de rayonner de bons sentiments, plus je me sens clandestin.
Tout ce qui est vrai s’échappe. Tout ce qui s’échappe est vrai. La vérité se promène sans arrêt entre le tout ordinaire et l’absolument ineffable, ce qui permet au premier imbécile venu d’affirmer en toute sécurité qu’elle n’existe pas, et de garer tranquille sa caravane sur le parking de Foku, le supermarché des opinions. Je le vois bien que tout ce qui est vrai s’échappe ! Les piétons s’échappent, les nuages s’échappent, tout s’échappe dans ma tête, la petite fille d’en face s’échappe. Et moi, sur mon balcon avec, derrière moi, le gouffre rassurant et sombre de l’affection tyrannique et, devant moi, cette rue Léon-Gambetta où il y a les Champs-Élysées, Venise et New York, le Sahara et le Grand Nord, immobile et radieux, projetant en vainqueur mon enfance sur la vie qui est devant moi, moi aussi je m’échappe !
C’est ainsi, dans ce mouvement d’échappée, qu’on peut voir le monde. Quand le professeur de français pose ses lunettes sur son bureau et nous parle des livres qu’il aime, que c’est beau la classe ! Et que le reste est laid, et que le sérieux est bête ! Le monde est à frôler, juste à frôler. Les autres ne sont ni à comprendre, ni à posséder, ni à convaincre, ni à ménager, ni à instruire, ni à gouverner, ni à protéger, ni à charmer, ni à détromper, ni à séduire, ni à sauver. Ils sont des signes, un vertigineux entrecroisement de signes. Les piétons de la rue Léon-Gambetta ne sont pas des solitaires juxtaposés ; ils sont les accords d’une symphonie que n’importe qui peut percevoir, les personnages d’un spectacle toujours renouvelé, les scintillements multiples du soleil. Le secret majeur que me révèle mon petit promontoire de ciment, c’est aussi le plus simple : nous sommes au monde, et c’est immense.
Qu’était-ce donc pour moi, la formation ? Le renouvellement et le retournement, en présence des autres et avec eux, de la problématique de l’enfance. Les locaux des entreprises sont bien plus confortables mais tout aussi décourageants pour l’imagination que les Habitations à Bon Marché de Montrouge. Cette grisaille, c’est le climat de mon enfance, c’est le bureau de mon père où je suis allé si souvent bâiller. La gentillesse méfiante de ces employés, de ces cadres, c’est celle de mes parents. Certains, comme le disait ma mère en parlant de mon père, gardent tout sur l’estomac. D’autres, comme elle, font les braves, puis sont contraints de renoncer. Tout témoigne de l’omniprésence d’un ordre qui n’a apparemment rien de monstrueux mais qui le devient par ce qu’il empêche, par sa patience inlassable pour user l’énergie des gens et limer leur spontanéité, par le climat de docilité et d’inexpression qu’il leur impose comme une évidence, par la pauvreté des relations qu’il suscite entre eux, par les silences et les concessions auxquels il les contraint, par la pusillanimité qu’il encourage.
Cette fois, c’est fini. L’enfance, en moi, ne perdra plus. No pasaran. L’enfance ? Ce qu’elle porte, plutôt : le désir d’une vie plénière, intégrale, sans laquelle c’est l’étouffement assuré, fût-il citoyen. La formation, pour parler comme au tennis, c’est, pour moi, le jeu décisif du match qui se joue, dans ma vie comme dans toute vie, entre ce désir-là et le monde. L’enjeu n’est ni de bricoler une autre organisation de la société, ni d’inventer une autre façon de se faire humilier par une autre sorte de caciques, ni de faire triompher son petit scénario préféré sur ce qui se passera après la mort, ni de dénicher la meilleure manière de garder la planète présentable. L’enjeu, c’est de faire entrer dans l’existence tout ce qu’on a gagné à la loterie de l’enfance, tout ce qu’on y a ramassé de trouble, de ravage, de ravissement, d’arrachement, de transport, de désespoir. L’enjeu, c’est de se présenter au monde dans la nudité exigeante de sa sensibilité, dans la conscience d’une absolue irréductibilité qui ne peut tolérer la moindre perspective de capitulation puisque c’est précisément en elle que réside la seule chance de rencontrer les autres sans se trahir ni les trahir.
Je n’ai jamais mieux appris à connaître mes semblables que dans ces salles anonymes. Ce que je leur ai proposé, je ne l’avais pas prémédité. C’est même à mon insu que la partie s’est d’abord engagée ; ensuite, j’ai pris la responsabilité du jeu. L’effrayant formalisme de la vie économique m’avait renvoyé au conditionnement de mon enfance ; mais, cette fois, je n’étais plus contraint de chercher une protection dans les caches solitaires de la rêverie. Tout ce que j’avais vécu, senti, pensé, les épreuves comme les plaisirs, les assentiments comme les refus, les adhésions comme les combats, m’avait conduit à reconnaître et à choisir les impulsions fondatrices de l’université du balcon ; plus j’avançais dans mon travail, plus je les voyais sortir de mon cœur en fanfare comme, de leur caserne, les cavaliers des westerns.
Dans cette aventure, j’ai d’abord cherché ma propre exaltation. Charité bien ordonnée… Si quelqu’un entrait dans la logique que je proposais, je pensais à quelque affinité de tempérament ou d’expérience. Mais, au fur et à mesure que je donnais plus de consistance à ce qui n’était d’abord qu’une intuition assez vague, la contagion s’étendait trop rapidement pour que je puisse maintenir cette hypothèse. Je m’étonnais de trouver une sensibilité proche de la mienne chez des gens avec qui je ne me sentais aucun point commun, que mon discours agaçait et qui me critiquaient. Nous étions pourtant bien plus proches que nous ne le pensions. J’apprenais peu à peu comment il faut regarder et lire les autres ; que les seules choses qu’il soit utile de chercher en eux sont celles qu’on est assuré de ne pas y trouver ; que la seule chance de les comprendre un peu, c’est de se faire complice de leur mystère. Prendre conscience de cette proximité était une expérience émouvante. Mais le plus difficile, une fois que nous l’avions reconnue, était de nous retrouver ensemble sur une crête étroite, de nous demander ce qu’il fallait penser et faire pour ne plus retomber du côté où tout conspirait à nous entraîner, si c’était là une chose envisageable, et qui de nous relèverait le défi, et qui y renoncerait.
J’apprenais peu à peu que cette protestation instinctive, cette insurrection vitale n’était pas seulement mon affaire, mais l’affaire de celui-ci, de celle-là. Et pas seulement l’affaire de celui-ci ou de celle-là, l’affaire de chacun de nous. Et pas seulement l’affaire de chacun de nous, l’affaire de nous tous ensemble. Et pas seulement l’affaire de nous tous ensemble nous intéressant à l’organisation du monde, l’affaire de nous tous ensemble nous intéressant à nous-mêmes. Et pas seulement l’affaire de nous tous ensemble nous intéressant à nous-mêmes, l’affaire de nous tous ensemble nous intéressant à ce que nous ignorions de nous-mêmes. Et pas seulement l’affaire de nous tous ensemble nous intéressant à ce que nous ignorions de nous-mêmes, l’affaire de nous tous ensemble prenant la parole au nom de ce que nous ignorions de nous-mêmes. Et l’affaire de nous tous ensemble prenant la parole au nom de ce que nous ignorions de nous-mêmes, l’affaire de nous tous ensemble larguant, une fois pour toutes, les amarres, c’était, c’est, ce sera l’affaire de n’importe qui, n’importe où, n’importe quand, c’est sa voix, votre voix, ma voix lorsqu’elle s’élève pour rien, vraiment pour rien, simplement parce qu’elle n’est pas seule, et qu’elle le sait.
Nous sentions tous aisément de quoi il était question, mais que nous avions de mal à en parler ! Le sens de ce que nous vivions, chacun le tirait à lui. Pour l’un, il s’agissait d’un appel direct à la spiritualité, à l’intériorité, à la religion. Pour l’autre, d’un avatar libertaire et soixante-huitard du jouir sans entraves. Un troisième, en cours de psychanalyse, ne manquait pas de repérer des résonances freudiennes. Un autre encore était persuadé qu’une telle prise de conscience était un accompagnement nécessaire des luttes sociales. Des ingénieurs proclamaient que des sessions comme celles-là étaient très profitables à l’entreprise, qu’elles aidaient les gens à devenir autonomes, qu’elles leur apprenaient à dire je, ce qui faciliterait la communication. Et de citer un de leurs héros, un patron qui, au pot annuel, n’hésitait pas à inciter les jeunes cadres à rester eux-mêmes et, comble de liberté, à porter des chemises de la couleur qu’ils voudraient. J’écoutais, je ne riais pas, j’étais plutôt ému.
Les mots ne suivaient pas. Comment l’auraient-ils pu quand le monde n’offre plus de résonance collective aux impulsions de l’enfance et du désir, quand il méprise le lien gratuit avec les êtres, le compagnonnage sans cible ? Qui peut trouver tout seul des mots pour désigner ce qui n’existe pas ? Alors nous revenions à ce que nous connaissions ; nous déplorions des injustices, nous condamnions le pouvoir de l’argent, nous fabriquions de très vraisemblables boucs émissaires : et tout se terminait par de pauvres slogans qui nous navraient.
À quoi pouvaient-elles bien servir, ces sessions ? À peu de chose. À forer un peu, à vriller, à percer des abcès, à donner une chance à autre chose, à aider à une fermentation, à être cette légère inclinaison qui fait se rencontrer les atomes. Que rêver d’autre pour ce site ? Un pas après l’autre dans la nuit : nous verrons bien où cela nous mènera. Aucun risque en tout cas pour le visiteur d’être conduit aux portes d’une chapelle, d’un parti, d’un club. Non pas qu’on ait fait vœu d’éclectisme. Non pas qu’il ne se trouve dans ces chapelles, ces partis, ces clubs, de belles intelligences et de grandes bonnes volontés. Mais les liens qui s’y créent entre les êtres y sont désormais, quoi qu’on fasse, obsolètes, réducteurs, stérilisants. Ainsi va l’époque. Elle ne nous pose plus la question de ce que nous devons faire ensemble. Elle nous demande qui nous sommes. Elle nous invite à des explorations nouvelles dont nous ne devrions pas rapporter beaucoup plus que quelques traces de confiance, quelques fragments d’espérance que nous sommes très loin de savoir utiliser.
Mais j’hésite. Est-ce si sûr que tout le monde ait fréquenté, dans son enfance, une université du balcon ou quelque chose de ressemblant ? Pour beaucoup, ces instants-là n’ont-ils pas été si rapides qu’ils se sont fondus dans l’apprentissage fonctionnel du métier de vivre ? Qu’est-ce que la rêverie pour un enfant riche, ou pour un enfant pauvre élevé dans l’obsession de la promotion sociale, sinon la réduplication des apparences ? Ceux-là ont-ils vraiment eu le temps de comprendre que le monde est large, qu’ils l’ont reçu et non pas inventé, qu’ils ne le conquerront jamais, que la soif qu’ils en ont devra rester inassouvie, qu’elle les conduira à la colère et aux larmes ? Qu’y a-t-il en eux, une enfance ou une décalcomanie des grimaces des adultes ? Sont-ils encore touchés par ce qu’un enfant suggère de confiance, terrifiés par ce qu’il condense de violence, charmés et inquiets de sa capacité de mimétisme ? Ne l’a-t-on pas chassé de leur souvenir, le temps où ils étaient tout entiers dans le désir, et donc dans l’excès ; dans la découverte, et donc dans la largeur ; dans l’instant, et donc dans l’inachevé ; dans le mouvement, et donc dans la déstabilisation ? Comment en serions-nous venus, si ce n’était pas le cas, si tant d’enfances n’avaient été mutilées de manière irréversible, à fabriquer une société qui propose aux hommes et aux femmes des modèles de vie et des idéaux qui les mettent en contradiction radicale et permanente avec ce qu’ils ont d’abord été ?
J’étais souvent frappé, dans les sessions, par la tristesse insondable, désertique qui se lisait sur certains visages quand nous en venions à évoquer l’esprit d’enfance. Comment dire sans provocation mais avec netteté, sans esprit de revanche mais avec force, que l’enfance et le peuple sont si fortement liés qu’un peuple qui se détourne de son enfance n’est plus qu’une population ? Aurais-je vraiment eu de la chance si, à dix ans, j’avais vu toutes les portes de la vie se fermer devant moi pour ne laisser ouvert qu’un interminable couloir de la mort et, au bout, sans surprise, l’exécution par l’argent, la carrière, l’image ? Est-ce vraiment une malchance que de se sentir vivre ? Faut-il expier cette chance-là soit en se grimant pour faire plus riche que les riches, plus mort que les morts, soit en s’arc-boutant aux caricatures grotesques où les défenseurs intéressés du peuple se plaisent à l’enfermer, à moins, encore, de se laisser euthanasier à petit feu par la télévision, ses paillasses foireux, ses attendris de métier à l’exquise sensibilité de varans ?
J’abordais ce site sans volonté de pessimisme, mais sans parti pris d’optimisme. Retrouver une enfance, retrouver un peuple… Diable ! Et puis, merveille, le hasard me fait signe. Je feuillette le Dico du français qui se cause. Je tombe sur le verbe baliser. C’est en 1982, dit Pierre Merle, que l’expression argotique baliser, qui signifie, comme chacun sait, avoir peur, « arrive sur le marché ». Et en 1986-1987 qu’elle se répand. « Sur le marché » : on ne peut mieux dire.
Balisés, ils vont l’être, les citoyens. Dans leur temps, dans leurs mots, dans leurs initiatives, dans leurs amours, dans leurs idées, dans leurs colères, balisés dans leurs valeurs par des voleurs, balisés dans une pitoyable obéissance et dans des libérations aussi pitoyables. C’est le néo-paradis de la postmodernité. La gauche entrepreneuriale. Tapie l’épatant. L’émouvante réconciliation du peuple avec les entreprises. L’argent roi. La communication. Le début de la dictature des objectifs. L’exacerbation de la névrose de la compétition. Toujours plus sophistiqué, et toujours d’autant plus niais qu’il est plus sophistiqué, le management mélange dans son shaker ce qu’il a récupéré dans les poubelles de l’actualité. Quand la culture n’est pas un défoulement offert à la libido populaire, c’est un cordial pour entretenir le moral des managers, une plume qu’on leur plante dans le cerveau pour les confirmer dans leur distinction. Les sciences humaines dissipent les rassemblements suspects mieux que les lacrymogènes. L’enseignement prépare au marketing et aux plans sociaux. Les loisirs sont la sieste du troupeau. La vie est une panade. Le monde, le studio où la panade se tourne en live.
Baliser, murmure à part soi le peuple, c’est avoir peur. Voilà la seule chose sérieuse qui restera de cette époque, et qui doit suffire à nous donner un moral d’enfer. Dans sa déconcertante simplicité, ce mot-là dit tout. Bien sûr, il plonge plus profond que le siècle : la modernité a tout exacerbé, elle n’a rien inventé ! Mais cette découverte anthropologique majeure qui « arrive sur le marché » au moment où l’esprit d’enfance est persécuté comme jamais, où l’humain est rogné et rongé comme un ongle, c’est bien autre chose qu’un commentaire goguenard. Considérer de sa fenêtre la puissance du monde, s’en détacher un instant et laisser se tramer au fond de soi d’étranges histoires d’amour entre les mots et les sentiments, c’est précisément cela l’esprit d’enfance, une des formes les plus achevées, les plus libres, les plus amicales de l’intelligence. Et naturellement, au regard des gamineries veules de la modernité, la plus adulte.
Baliser, repérer. En amont, la phobie de ce qui est large, l’incapacité non seulement de se jeter à l’eau, mais encore de se sentir porté par le courant. Le petit repli sur soi. Surtout, ne pas aller jusqu’à ce qu’on ignore : se cacher comme une concierge derrière la porte de son moi. Noter le passage des autres, le bruit de leur pas, le son de leur voix. Haine de soi, prodigieuse haine de soi. En aval, la logique diabolique. Sérier les objectifs, disséminer l’humain. Rétrécir encore les couloirs. Parier sur deux insatisfactions. D’abord, celle que ne manquera pas de suggérer cette étroitesse elle-même. Ensuite, l’objectif atteint, celle que suscitera le désagrément de ne pas l’avoir assez, ou assez bien, atteint ; au cas où il l’aurait parfaitement été, celle du désir frustré de ne plus rien avoir à désirer. Alors, lâchez les chiens, la violence est enfin avancée, celle qu’on désirait assouvir depuis si longtemps, depuis qu’on se fait l’abominable reproche de ne pas exister, de ne plus être un enfant, ou de ne l’avoir jamais été.
Sur mon balcon, la seule souffrance qui m’étreignait me venait d’une question si torturante que j’osais à peine me la poser : suis-je seul avec ce que je sens ? La rue Léon-Gambetta ne manque jamais de m’accueillir dès que j’ouvre la porte-fenêtre, mais les autres, mes lointains semblables, où sont-ils ? Pourquoi ne me confirment-ils jamais qu’ils existent, qu’ils ne sont pas des ombres, des échos, des principes, des potentialités jamais réalisées ? Un peu de mauvaise foi, et on se contente de ces approximations, on négocie avec elles ses plaisirs, ses ambitions, on se persuade à qui mieux mieux de l’existence de ce qui n’existe pas. C’est la grâce de l’enfant solitaire que de ne pas avoir accès à cette facilité, à cette séduisante malchance. Pour lui, l’esprit du monde, jusqu’à ce qu’il l’ait vaincu, reste un irréductible adversaire. Non pas les gens, bien sûr, mais ce qu’ils acceptent d’accueillir en eux sans en faire l’inventaire, leur façon de reconnaître le gouvernement des choses, de les autoriser à exister sans eux, de faire croire qu’ils avancent sur un terrain connu, dûment signalisé, et qu’il suffit, pour être un homme, d’y bêler quelques bons sentiments et d’y pousser quelques cris. L’esprit du monde, c’est un accord trop vite donné, signé du bout du cœur ; un frein constant à l’authenticité, l’asphyxie par carence en rêve, l’irrémédiable engorgement de l’esprit.
Un bonheur incommunicable, c’est un bonheur malheureux. J’ai longtemps connu l’angoisse. J’ai mis beaucoup de temps à en apprendre le langage, à en retourner le sens comme la peau d’un animal qu’on dépèce. Elle a l’air de me clouer à mon passé : elle me fait signe que l’avenir m’attend. Elle paraît me river à moi-même : elle ne me parle que de grand large. Elle m’épure, elle me simplifie, elle me déblaie, elle me fortifie. Elle m’explique que ne plus être seul, ce n’est pas guérir de la solitude. Ma solitude n’est pas une prison, c’est un porche, un premier pas, un matin. Ce que je sens sur le balcon, d’autres, autrement, le sentent aussi. Ils viennent, ils arrivent. Un jour, un jour dont je ne sais plus rien, je m’aperçois qu’ils étaient là, que je suis arrivé à ce qui commence.
Alors, pour parodier le titre d’un livre célèbre, commence l’extension du domaine de la vie. Les autres ne sont plus ces camarades de régiment avec qui l’on marche au pas, avec qui l’on va en quartier libre, avec qui l’on n’évoque jamais, pour les redouter ou pour feindre d’en plaisanter, que les circonstances de la commune captivité. Il en est tant des régiments, et de si raffinés, et de si délicats, et de si savants, et de si altruistes, et qui enferment plus sûrement que le vieux service militaire ! L’autre n’existe que lorsqu’il ne se déduit pas de la circonstance, lorsqu’il la fait éclater comme une coquille. Il ne suffit pas d’être des compagnons de banc sur la galère du bavardage démocratique. Ni des équipiers exaltés par les serments de victoire qui les lient. Ni des partenaires qui négocient la meilleure façon de vivre ensemble. Ou tout cela si l’on veut, après tout ! Mais tout cela n’est rien ! L’autre, il n’y a pas plus de raisons qu’il soit là que je n’avais de raisons de naître. L’autre, c’est l’enfance continuée. L’autre, c’est le retour au point de départ absolu. L’autre, c’est l’endroit ; même sublime, tout le reste est l’envers.
J’ai vu des gens vertigineusement éloignés de leur enfance ; les plus proches en étaient encore séparés par des milliards d’années-lumière. Mais, de ma vie, je n’ai jamais vu personne qui ne la porte en soi comme un poignard. À cette souffrance-là, si cruelle qu’elle soit, il ne faut souhaiter à personne d’échapper. Elle n’annonce pas la mort de l’enfance, elle n’en dresse pas le bilan désastreux. Elle dit qu’elle commence, qu’elle est là, presque là. Elle la réactualise en la libérant de ce qui l’a fanée. Ce n’était pas le souvenir de l’enfance qu’ils cherchaient, les balisés de la formation, quand un brouhaha emplissait la salle et que tout le monde se mettait à parler à tout le monde. C’était l’enfance elle-même qu’ils demandaient au voisin, à la voisine. Et qu’ils trouvaient : elle, l’enfance, pas son souvenir ! Ils la cherchaient pour eux, pour les autres, pour l’avenir, pour le monde. Ils étaient à cet instant-là les militants d’un parti qui n’existera jamais, dont l’existence serait la négation : le parti de l’enfance. Ils étaient les militants d’une impossible politique de l’enfance, pas celle qui prépare des clones d’adultes, celle qui laisse aux adultes une chance de ne pas pourrir sur pied, de devenir des enfants lucides, impertinents, irrésistibles.
Un site Internet pour récupérer l’enfance, l’autre et le peuple ! C’est l’éditeur qui va rire ! Notez que, sur mon balcon, je ne me prenais pas vraiment pour le commandant d’un navire, ni pour un orateur… Mais le cœur y était. Il y sera encore, c’est tout ce que je peux dire. Pour le reste, on verra. Je tâcherai de chercher dans les autres, dans la vie, dans ma vie. Mais pas de promesses. Après tout, pour vous, ce site est gratuit. Vous admettrez qu’il le soit aussi pour moi.
(février 2003)