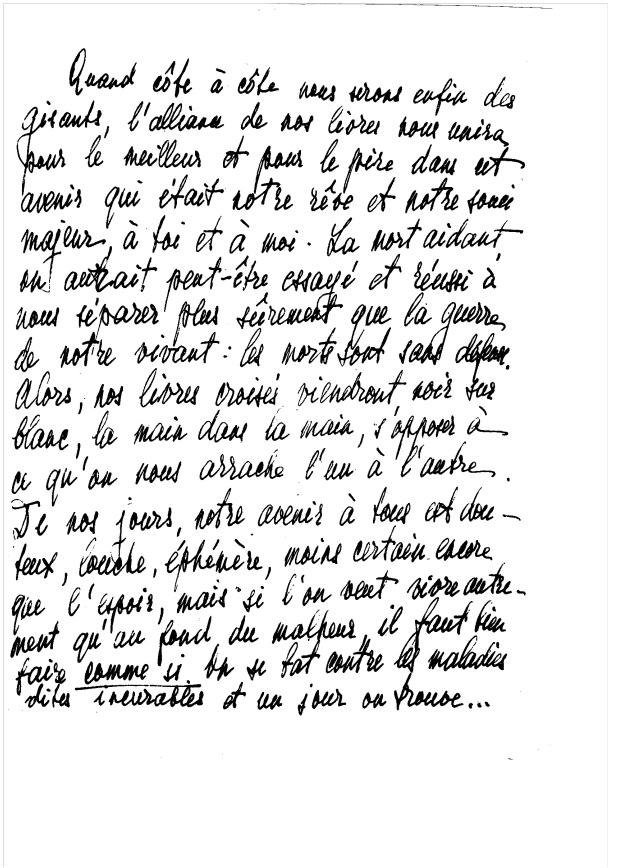pour Sonia
Sauvage, sauvagerie, ces mots me reconduisent à Saint-Julien-en-Born, chez Jacques Berque, quand il évoque devant nous les vacances d’enfant qu’il passait, venant d’Algérie, dans la maison où il nous reçoit et où il s’amuse à conseiller à mi-voix à son grand chien airdale d’aller mordre un peu les mollets de ma compagne. Il raconte longuement ces étés interminables, les inépuisables découvertes qu’ils lui offraient. Parlant de cette forêt gigantesque où, le matin même, nous nous promenions, il dit qu’il avait l’impression, enfant, de s’y ensauvager. « C’est un beau mot, s’ensauvager, vous ne trouvez pas ? » Oui, nous le pensons aussi, c’est un très beau mot. Et s’il sonne sans doute différemment dans nos têtes, aucun de nous trois n’aura l’idée de l’associer à un spectacle de violence auquel il aura assisté. Je comprends bien. Monsieur le Ministre a de l’expérience. Il a vécu les moments héroïques et pathétiques d’une campagne électorale alors que j’ai dû me contenter, moi, de quelques guéguerres de débutant… Ses communicants, pourtant, l’ont trompé : quelques brutes ne tuent pas un beau mot. Jacques Berque et Claude Lévi-Strauss lui parleront mieux du sauvage et de l’ensauvagement. Et bien d’autres encore qui sont prêts à le faire profiter gratis de leur savoir et même, s’il le faut, de leur expertise. Ainsi, si le 9-3 n’est pas entièrement persuadé de l’excellence des préconisations officielles, Ovide exilé prêtera une des clefs du mystère à M. Darmanin : celui que personne ne comprend, c’est celui-là le barbare. Si toutefois le ministre préfère la douceur confucéenne à la vigueur romaine, qu’il aille donc visiter, pour se donner du courage avant une périlleuse tournée des territoires en danger, le chapitre IX des Entretiens, point 13, dans la traduction de Séraphin Couvreur : « Le Maître aurait voulu aller vivre au milieu des neuf tribus barbares de l’Est. Quelqu’un lui dit : « Ils sont grossiers ; convient-il de vivre parmi eux ? » Il répondit : « Si un homme honorable demeurait au milieu d’eux, le resteraient-ils encore ? »
Jean-Pierre Chevènement avait parlé de sauvageons. Son tort était évidemment de s’exprimer en français, tare majeure qu’on ne peut reprocher à cette troupe de responsables politiques formée au yoga qui se tient prête, en toutes circonstances, à se tordre rituellement les bras d’horreur et d’épouvante. Sauvageon. Le mot nuance sauvage et le reflète. Un jeune qui grandit à la diable, qui n’a pas été greffé, qui s’est élevé tout seul et multiplie les bêtises. On lui fait les gros yeux mais l’indulgence ne peut pas être bien loin. Alain Rey, si savant, y voyait pourtant « un mot-masque pour définir l’ennemi de la société ». Une sorte d’invective, alors ? Mamma mia ! N’avait-il pas senti dans cette bougonnerie ministérielle une pointe de sourire, et même d’affection ? Qui a jamais entendu Jean-Pierre Chevènement invectiver quelqu’un ? Il gronde, il ironise, il fait un peu la leçon. Il n’injurie pas. Quand, bien plus tard, un autre ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, crut opportun de parler, comme lui, de sauvageons, je n’y vis qu’une maladresse, mais elle me toucha vivement. Sauvageons, cette fois, n’était pas le bon mot pour désigner quelques jeunes las de piétiner derrière une dialectique marxiste qui permet difficilement de se dégourdir les jambes et qui voulaient sans doute se persuader qu’en s’en prenant à une voiture de police ils contribueraient efficacement à effacer de leur pays toute trace d’aliénation en même temps qu’ils y consolideraient la paix civile. Cette erreur m’avait renvoyé à une expérience très difficile : je m’étais mis en tête, il y a quelques décennies, de venir en aide à quelqu’un dont la bonne foi me semblait évidente mais qu’il m’était impossible d’approuver sans réserve. Tâche presque impossible. Être utile à ces jeunes théorisés est moins aisé encore. Avec les sauvageons, on sourit. Avec ceux-là, on ne peut pas sourire et moins encore rire. On peut soutenir leur courage s’ils sont en prison, on peut leur offrir de l’amitié. Mais on ne triche pas. On ne s’extasie pas quand ils récitent leur leçon, on ne les tient pas pour des prophètes, des maîtres à penser, des héros, des pointures. Avec eux, on discute, et sec, et dur. On ne fait pas semblant d’approuver en eux ce qu’on n’approuverait pas en soi. On ne joue pas au joli révolutionnaire comme on joue au joli cœur. L’amitié, c’est de leur dire qu’ils se sont trompés et qu’autre chose est devant eux. C’est de vérité qu’ils ont besoin, non pas d’habileté ni de « pédagogie ». Tout calcul les méprise, les enfonce et participe de la fumisterie communicationnelle. Il est moins inquiétant de les voir injurier ceux qui veulent les aider que de les voir patauger avec eux dans la bouillasse du bavardage. Quand on lui fit remarquer que les petits goujats dont parlait Jean-Pierre Chevènement étaient assez loin de ce profil de théoriciens agressifs, Bernard Cazeneuve m’a beaucoup amusé en argumentant penaudement que, dans sauvageon, il y a sauvage. Incontestable. Mais, comme dirait un professeur, ni la dénotation ni la connotation de ces deux mots ne coïncident. Pas plus que celles de corniche et de cornichon, sauf peut-être à Saint-Cyr.
Si sauvageon nuance et fait oublier sauvage, sauvagerie et ensauvagement le renforcent et l’aggravent. Trêve de délicatesse, c’est le terme que vient de choisir un troisième ministre de l’Intérieur, l’actuel. Les uns, naturellement, s’indignent de sa sévérité tandis que les autres, cela va de soi, se réjouissent de sa fermeté. Débat sans intérêt. Je renvoie à Paris Match les amateurs de parler pour ne rien dire : pour trois euros on pouvait y avaler, l’autre semaine, un papier sur la question qui la dévitalisait et la rendait insignifiante : après les arracheurs de dents, les arracheurs de sens. Parlant d’ensauvagement, c’est-à-dire condamnant frontalement et sans nuances des pans entiers de la société qu’il est censé servir, notre ministre me semble participer de la même insensibilité – sans doute compréhensible chez un homme politique dont le référent majeur est un personnage assurément fort intelligent et avisé mais si peu attentif à la signification de son époque qu’il confondait naguère l’un de ses plus lucides témoins, Roland Barthes, avec une ancienne gloire du tennis. La question, s’il y en a une, n’est pas du tout de savoir si le ministre est ferme ou sévère : avec des mots différents, le baragouin approbateur et le charabia désapprobateur disent la même chose. Et là, il faut rendre grâces à M. Darmanin, presque autant qu’à Christophe Colomb. Son outrance découvre un continent de pensée alors que le président de la République, quand il choisit prudemment de parler de banalisation de la violence, ne découvre rien du tout. La question universellement éludée ne peut en effet apparaître dans sa largeur et dans sa vérité que lorsqu’une évidence majeure est versée au dossier : pour les uns comme pour les autres, à la seule exception de Jean-Pierre Chevènement, l’idée de sauvage est péjorative, fondamentalement péjorative, seulement péjorative. Ces deux syllabes ne peuvent s’entendre qu’en mauvaise part. Ne peuvent susciter que de la réprobation. Dans tous les cas, sauvage, c’est mal. Sauvage, c’est négatif. Sauvage, c’est à bannir. Ou à cacher. Sauvage, ça fait peur. Voilà très précisément ce qui ne va pas de soi. Qui ne va pas du tout de soi. Voilà précisément – personne, dans son for intérieur, n’en doute – une énorme sottise. Peut-être quelque chose comme la sottise originelle de nos sociétés, la mère de toutes nos sottises.
.
Saint-Julien. L’hôte a beau être un puits de science, ce n’est pas le savoir qui donne son parfum à cette maison. On se sent dans un beau campement. On est arrivé à un point de départ. On y regarde le monde et le temps avec les yeux d’Ulysse, méfiance et connivence. Par-dessous. De bas en haut, comme pour leur donner forme. En vérin. C’est beau, c’est dangereux, c’est vrai, c’est sauvage. Sont exclus la curiosité, la comparaison, le pittoresque. Tout est jaillissement, résurgence, correspondance. Pesanteur légère. Simplicité, mais affirmation. Indissociablement présence et passage. Pas de part d’ombre, l’ombre est dans la lumière. Quand des êtres, des lieux, des œuvres ne me donnent pas ce sentiment, je les sais inaboutis et, en tout cas, insincères. Au re-voir ! Au re-faire ! Contrairement à ce que dit Gérald Darmanin – mais en est-il si sûr ? ne trouverait-il pas en lui parfois, par exemple, un certain goût de la solitude ? – le seul label de vérité, le seul poinçon de la valeur, c’est le sauvage. L’étonnant, à Saint-Julien, c’était que le travail du penseur et le climat qu’il suscitait dans sa maison étaient profondément en harmonie. Toute l’œuvre de Berque tourne autour de cette problématique du sauvage, de l’ensauvagement et du désauvagement, du mystère que réveillent ces mots, de l’inquiétant entremêlement qu’ils évoquent, de l’impossibilité de séparer en eux ce qu’ils suggèrent de désir et de refus, de naissance et de mort, de danger et de salut, de clair et d’obscur, de désastre et d’espérance. Tous les aspects de l’immense dialogue entre le monde arabo-musulman et les sociétés occidentales que constitue cette œuvre sont imprégnés de cette dialectique de l’historique et du fondamental qui en est comme la formulation abstraite ; elle vaut pour le monde comme pour chaque société, pour chaque pays comme pour chaque classe sociale, comme pour chaque individu considéré dans la diversité de ses « sortes ». Mais ce qui, surtout, me touchait, c’était que la vie profonde qui anime cette pensée, sa générosité, sa largeur étaient perceptibles dans son expression elle-même, dans son ton, dans la musique de la parole ou de l’écriture de Jacques Berque. Elle ne s’inclinait devant personne et ne chassait personne. C’était une pensée de compréhension, de consentement, le contraire d’un moralisme de frustrés et d’aigris. C’était une pensée de force, d’espérance, de patience – et, en dépit de tout, une pensée de joie.
Alors ? Si le sauvage est le monstrueux, plus d’inconnu à l’horizon. Plus d’inquiétude doublée d’heureuse curiosité. Plus de je ne sais quoi. Plus d’au-delà, donc plus d’élan. Le monde est à crever, que ceux qui y tiennent y crèvent mais, nom de Dieu, que les autres se réveillent, et sans en demander l’autorisation, ceux qui tiennent à la terre et à la vie par le cœur et par le sang et par l’esprit et non pas par des valeurs de plastique vendues par des gens qui n’ont que de la carrière dans le ciboulot !
Christiane Taubira n’a pas tort de juger que les mots qu’emploie le ministre en disent davantage sur lui-même que sur les personnes qu’il prétend viser. Je ne pense pas, par contre, que l’imaginaire colonial, devenu l’une de ces précieuses éponges de la gauche militante qui lui permettent de ne jamais s’en prendre sérieusement à une modernité qu’elle n’a ni le goût ni les moyens électoraux de refuser vraiment, joue un très grand rôle dans cette affaire. Le mot ensauvagement, quand je l’ai entendu dans la bouche d’un ministre – et qui, Taubira a raison, était une photographie de sa vision du monde – n’a pas évoqué en moi les souvenirs de la colonisation mais bien l’actualité de la société dont il est l’un des protecteurs : plutôt que Lyautey ou l’Algérie française, j’y ai reconnu l’horreur économique, le règne technocratique, la suffisance des élites et le triomphe de la propagande. J’ai eu envie de crier, comme sur le terrain de foot : Hors jeu ! J’ai eu un sentiment de mort, comme en 2002, chez le spécialiste qui venait de me tirer de mon cancer, ce jour où je lui avais parlé d’un ami de trente ans, mon conscrit de 1933, qui souffrait du même mal et m’avait communiqué la veille le résultat de ses analyses. « Il est à 50, Docteur, est-ce que vous pensez… » Il m’avait regardé droit dans les yeux, il ne s’habituait pas à l’habitude. « Il est foutu, M. Sur. » Quinze jours après, au Père-Lachaise, je parlais à son cercueil. Un cimetière où plus rien n’est vraiment sauvage, voilà ce que m’ont évoqué les propos de ce ministre, un cimetière de l’espérance où les gens comme lui semblent ignorer qu’ils s’enterrent les premiers.
Je regrette et réprouve de toutes mes forces la violence qui envahit certains de nos quartiers mais je ne peux oublier où est son modèle, où son moule, et que les provocateurs que l’on montre du doigt ne sont au mieux que de médiocres accélérateurs. Parlant d’un jeune homme récemment arraché par une vingtaine d’abrutis à l’autobus dans lequel il était installé, une journaliste observait finement que non seulement la lâcheté de l’opération ne troublait pas ces imbéciles mais qu’ils étaient fiers de se filmer et entre-filmer 1. « Quand on a la force, c’est très bien comme ça », ironisait-elle. Une République digne de ce nom aurait la droiture et le courage de comprendre que ce propos résume très exactement le langage de sa vie économique, de ses médias, de ses élites congénitalement mesquines. Que ce cynisme est devenu son fondement, sa structure, son principe. Qu’elle l’a projeté sur la détresse de ces banlieues ou territoires qu’elle ne sait même plus de quel nom désigner comme elle l’a projeté sur la veulerie satisfaite de ses beaux quartiers, fabriquant ici une jeunesse hautaine, hypocrite, intéressée, servile, et là une jeunesse affolée, hurlante, vacante, dégoupillée, que des responsables légers et papillonnants, moins gueulards mais bien plus durs qu’elle, enfoncent impitoyablement dans les contradictions de son impuissance.
« Arthur Rimbaud fut un mystique à l’état sauvage, une source perdue qui ressort d’un sol saturé. » Tel est le début de la préface de Paul Claudel aux Œuvres complètes de l’auteur des Illuminations. Les sources perdues. La curiosité qu’elles provoquent. L’attrait qu’elles représentent. Le désir qu’elles suscitent. L’irréfutable présence de cet ailleurs. Voilà la dimension du sauvage, hors de laquelle la vie est aussi nulle que mon agence bancaire, une page d’informations Orange, un conseil d’administration de Veolia ou une session de formation au management. C’était un puissant qui tenait ce langage, homme d’affaires fortuné, diplomate, ambassadeur à Tokyo et à Washington, académicien, auteur dramatique et poète glorieux sur tous les continents, mais un puissant que sa puissance n’enfermait pas dans un bavardage agencé par une écurie de communication. Ce Rimbaud que les services de police d’un lointain prédécesseur de notre ministre connaissaient parfaitement, et que Paul Claudel, d’emblée, a « cru sur parole », n’était pas pour le poète une rencontre pittoresque. Ce n’est pas en dépit de sa sauvagerie qu’avec l’Évangile – à un moindre rang, mais dans le même ordre que lui – Arthur Rimbaud restera pour lui, toute sa vie, l’Interlocuteur, le Parlant, le Voyant : c’est à travers cette sauvagerie, par elle, avec elle. Disons-nous bien que la dimension que méprise aujourd’hui la légèreté convenue du pouvoir était le pain et le vin de Paul Claudel. Entre les deux, il faut choisir. Il y a, au sommet de la société bourgeoise, une contre-révolution d’une violence inouïe et d’une immense signification. Le monde moderne en est le produit mais la quasi-totalité des grands esprits du XXe siècle, tous ou presque d’origine bourgeoise, seraient en désaccord radical avec les intuitions et les intentions de nos oublieuses et ingrates élites. La passion de la justice, une vision héroïque de l’homme, le mépris de la férocité marchande, ces rivières se jettent dans le même fleuve de refus. N’oublions pas d’ailleurs que la sauvagerie était aussi entrée dans la vie du poète par une autre voie, celle du génie de Camille, cette autre sauvage, sa sœur. Entre cette terrible affaire que la pesante famille ne sut ou n’osa jamais résoudre – Claudel parle quelque part de ses « iniquités énormes » – et le « Nous ne sommes pas au monde ! » de Rimbaud, il fut, toute sa vie, confronté au sauvage. Tous les humains le sont, sauf ceux qui lèchent les sociétés crevées. Le contraire du sauvage, ce n’est pas le civilisé. C’est l’enfermé, le niais, le lâche.
Le personnage de femme qui donne son titre à la pièce de Jean Anouilh, La Sauvage, a fourni au théâtre français l’une de ses plus célèbres répliques : « J’aurai beau tricher et fermer les yeux de toutes mes forces… Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m’empêchera d’être heureuse… » Je veux bien qu’on la dise pessimiste, cette réplique, mais l’optimisme qu’on lui opposera, s’il refuse d’accorder à la conscience cette dimension infinie, s’il hésite à la penser comme un grand pont de hardiesse lancé sur le vide, comme une provocation adressée au néant et qui le nargue, ne rassurera que de doctes nigauds. La Sauvage a compris la nature du sauvage. Pour reprendre le mot de Claudel dans Le Soulier de satin, il est l’Irrépressible. Le sauvage, c’est ce qui, en nous, résiste à l’enfermement. Le sauvage, c’est la voix, en nous, de ce qui étouffe. Poète, cordonnier ou attaché de communication, tout être humain a les pieds, ou la tête, ou les deux, dans l’inachevé. Naturellement, sa frousse aidant – qu’il appelle le plus souvent liberté – il peut faire comme si cela n’était pas et les agiter avec tant de vigueur, ses pieds, sur le plancher des choses connues que tout le monde finisse par oublier son lieu de naissance. Mais, dans ce cas, c’est l’inquiétude humaine qui se trouve déclassée. Qui se sent inutile et désaccordée. Qu’il condamne à errer sur des routes qui ne vont nulle part, dans des ports vides de navires. Elle n’est plus cette voie semblable et différente que tout être humain se sait invité à emprunter et qui, à la fin des fins, le rapproche de ce qui est, de ce qui vaut, de ce qu’il est grand et fort de calculer. Elle n’est plus qu’une agitation prétentieuse, un embarras inutile, un lugubre vertige, une crétinissime accumulation de ce que le diable, qui aime se moquer du monde, appelle des biens. L’inquiétude humaine déclassée, c’est cette femme qui raconte à la radio son travail de commerçante. Certains produits se vendent tout seuls mais, pour d’autres, il faut expliquer, rassurer, convaincre. « C’est là, dit-elle, qu’on voit toute la valeur de l’humain. » La valeur de l’humain ! Mais c’est vous, Madame, l’humain, et si ce n’est pas vous, c’est une foutaise ! C’est vous avec tout ce que vous n’osez pas dire, même pas à vous-même ! Rien d’autre à chercher, pas la peine de regarder les nuages et, encore moins, les courbes et les statistiques ! L’humain pour vendre les produits ! Voyez-vous, oui ou non, où nous en sommes quand le cœur du langage populaire, violé par surprise, est salopé par un langage inventé par des escrocs ? À ce point de dévitalisation générale, personne ne peut reprocher à personne, quelque rang qu’il occupe, de n’avoir plus les moyens de faire face. Quand la vie politique, vidée de toute substance, meurt de dessèchement, quand la vie culturelle, privée de transcendance, périt d’indifférenciation, quand il faut avoir de très solides intérêts dans les affaires pour continuer à associer l’adjectif économique au grand nom de vie, il est injuste de mépriser ceux qui ne peuvent plus se tenir debout dans le cyclone, à moins que, s’ils y réussissent encore un peu, ce ne soit l’effet des vents contradictoires que déchaînent sur eux les mécontentements. Quitter un poste pour bondir sur un autre, comme on le voit à chaque élection, est un réflexe de lapin de garenne affolé. Partir pour rentrer chez soi, pour regagner sa base, pour se nourrir de ses fondamentaux, rien de plus digne et de moins contestable, des Romains à nos jours. Si vous ne pouvez plus, ne faites pas semblant. Partez. Notre estime vous accompagnera.
.
Pour gagner son combat contre la violence, le ministre de l’Intérieur dénonce les sauvages, la sauvagerie et l’ensauvagement. Si, ces violents, il les qualifiait de brutes, on ne le lui reprocherait pas. Sauvage est d’un tout autre registre. Un sauvage peut être violent – un civilisé aussi – mais ne l’est pas forcément. Ni le mot ni l’idée ne se laissent enfermer sur le territoire de la violence. À quoi s’en prend donc M. Darmanin ? À qui, au juste ? À qui et à quoi qui n’est pas la violence ? La réponse est évidente : à tout ce qui se réfère – ou pourrait se référer – à l’inconnu, au mystère de l’origine, à l’impensé, à l’impensable. À ce qui, dans le mot sauvage, évoque l’inconnu, l’inconnaissable, l’incernable. Nous sommes ici entre Gustave Flaubert et Léon Bloy. Une bourgeoisie néo-positiviste défend ce qu’elle considère non pas seulement comme sa réalité mais comme la Réalité : entreprise, patrimoine, réussite, gros sous. Toutes choses, naturellement, qu’elle ne désigne pas ainsi mais par toutes sortes d’euphémismes plus ou moins transparents qu’elle renouvelle de siècle en siècle. Valeur est le plus classique – au singulier ou au pluriel. On dit aussi maintenant nouveau monde. Selon l’aspect particulier de cette réalité épaisse qu’on souhaite évoquer, on pourra également solliciter un vocabulaire particulier. Celui de la démocratie, évidemment, si l’on parle politique. Celui du progrès favorisera les synthèses idéologiques. Côté morale, on a tolérance – toujours contradictoire, mais néanmoins toujours tendance – et, depuis peu, le performant vivre ensemble. Quel est le point commun de tout cela ? Rien n’y est sauvage. Tout est bien d’ici, bien de ce temps. Tout est bien technique. Tout est bien circonscrit, bien défini, bien clos. Et c’est pour que tout soit encore mieux circonscrit, mieux défini, mieux clos, qu’en bannissant le sauvage et son insupportable odeur de vie, en l’assimilant au meurtre et aux meurtriers, le pouvoir resserre un peu plus les boulons. Et revient à l’essentiel du programme masochiste constitutif de la société qui installe les ministres : éliminer partout – mais d’abord là où elle fait le plus mal, c’est-à-dire en soi-même – l’insupportable pensée que l’horizon de l’ordre bourgeois ne serait pas le tout de l’aventure humaine et, idée plus monstrueuse encore, que cet ordre aurait à se référer. En dénonçant sauvages, ensauvagés et en cours d’ensauvagement, M. Darmanin nous désigne notre prison, il offre à un dieu imaginaire qui ne mérite pas la majuscule le sacrifice qui le retiendra de rendre la vie intolérable au bourgeois, je veux dire vraiment vivante. Et, de manière accessoire, il nous dit la vérité du gouvernement auquel il appartient, la même, évidemment, que celle de ses prédécesseurs, la même, probablement, que celle de ses successeurs. Névrose ? Du tout. La névrose se soigne. Mauvaise volonté, alors ? Plus grave, je le crains. Goût du néant. Toute chose comme un pur signe de Rien.
.
« Non pas que nous devions retourner à la pensée sauvage – elle est toujours là, elle est en nous -, mais que nous ne devons pas en être honteux. » Cinéaste, écrivain, mais aussi ingénieur des Mines et docteur en physique, Harold Vasselin a découvert cette pensée de Claude Lévi-Strauss et en a été bouleversé. « Cela m’a vraiment traversé, culbuté, raconte-t-il sur Internet. On rencontre ainsi quelquefois, très rarement, une phrase qui déchire : voile, brume, paroi lisse, impossible d’avancer – et puis, tout d’un coup, « C’est possible, ça passe ». Elle se déplie, cette phrase : « toujours là », « pas être honteux », « non pas que nous devions ». On peut la goûter, la mâcher longuement : « Non pas que nous devions retourner à la pensée sauvage – elle est toujours là, elle est en nous – mais que nous ne devons pas en être honteux. » Il y a là un acte de foi, une position politique et morale, un projet intellectuel. Et il y a aussi, au dedans de cela, et c’est ce qui me traverse, un formidable mouvement, le geste d’une liberté gagnée. »
Pour répondre à ces images, une autre image en signe de reconnaissance. J’avais trouvé dans une revue, il y a une trentaine d’années, une très belle photo de Carolyn Carlson, la danseuse, à laquelle était joint ce court poème :
I live round the mountainside
In the cage you made for me
becoming
Un ami angliciste m’avait longuement commenté ce becoming : c’est ça me va, mais avec une nuance différente, l’idée d’un futur ou d’un inchoatif… Quelque chose comme ça me vient… J’y avais vu beaucoup plus qu’une tournure linguistique. Ou plutôt, j’avais senti que la langue accouchait ici, en effet, comme le dit parfaitement Harold Vasselin, d’un acte de foi, d’une position politique et morale, d’un projet intellectuel. Ce becoming, je l’avais entendu résonner dans les sessions quand, le dernier après-midi, quelqu’un reprenait autrement des propos que nous avions tenus et les teintait soudain, presque malgré lui, de sa sensibilité particulière, leur conférant ainsi, par cet autre éclairage, une vie qu’ils n’avaient pas encore jusque-là et changeant radicalement, en un instant, la nature de nos échanges : sous nos yeux, penser devenait un acte, un acte surgi tout seul de nos discussions, un acte sauvage.
.
Je m’engageais ainsi, avec Harold Vasselin, sur le chemin de la rêverie. Je ne l’ai jamais ignoré. Cette rêverie-là, qui ne triche pas avec la réalité, qui ne triche pas avec la solitude, qui ne triche pas avec le tragique, qui nous place et nous replace, mieux que tout, en face de nous-mêmes, et du monde, et de ce que nous pouvons y faire, est une amie fiable, désintéressée, indispensable. J’allais le reprendre, ce chemin de rêverie, ce mardi 15 septembre, quand m’est venue, sur France Inter, à l’heure des tartines, glissée avec indifférence entre deux informations, la nouvelle que la jeunesse ne prenait pas trop bien les conseils de prudence qui lui sont prodigués par le gouvernement. À preuve, une courte phrase d’une jeune fille expliquant que les jeunes entendaient « profiter de leur vie d’étudiants ». J’ai lâché la tartine et haussé le son : les commentaires, bien sûr, ne manqueraient pas. « Profiter de la vie d’étudiants » a ici un sens précis : oublier les risques qu’on fait prendre à d’autres – à des gens, pour la plupart, plus jeunes que moi comme à ceux de mon âge, mes conscrits. J’ai bien écouté. Mais non. Rien. Pas un mot. Pas l’ombre d’une indignation, pas un froncement de sourcil. Les nobles caractères et les âmes d’airain ne manquent pas dans cette station, les crécelles non plus : comment tout ce beau monde a-t-il pu laisser cette rondelle de saucisson pourrie dans le sandwich de l’information ? Pensait-on que le client n’y verrait rien ?
La jeunesse, la jeunesse… Disons plutôt les jeunes adultes : c’est la tranche des 20-30 ans qui s’expose le plus imprudemment au virus. Avec d’autant plus de vaillance qu’elle sait pertinemment que les dégâts sérieux ne seront pas pour elle. Je dois dire que j’ai la nostalgie, ces temps-ci, du vert langage de la Solo – le HBM préféré de Coluche, à Montrouge, qui a été aussi le mien jusqu’à mes vingt et un ans. Entendre dans l’arrière-gorge de tant de commentateurs ou d’invités ce roucoulement de pitoyable indulgence quand ils expliquent avec une émotion grumeleuse que les années d’études sont aussi les années du plaisir met terriblement à l’épreuve ma volonté de résister au mépris. J’ai l’impression de feuilleter le catalogue de chez Nullité.com. Voir des adultes retomber comme des flans est écœurant. Je ne crois pas à leur sincérité. Je ne crois pas à leur loyauté. Je ne crois pas à leurs souvenirs. Je ne crois même pas à leurs fiestas d’antan, ils les truquent. Je ne vois pas en eux un atome d’authenticité, un sous-gramme de vérité. Ils sont lâches et ils lèchent. Enfin, d’où est-ce que je parle ? Est-ce une nouveauté si la jeunesse va au plaisir et si elle y va, dans la majorité des cas, de la manière la plus convenue ? C’est ainsi, voilà tout, le plus souvent elle m’agace et je la plains, parfois la nostalgie me prend et je l’envie, comme tout le monde : où est le problème ? Mais si elle sait, au milieu de la fiesta, qu’une saloperie de petite bestiole contre laquelle elle ne peut rien va en profiter pour tuer des gens avec sa complicité consciente et donc volontaire, peut-on encore considérer ses divertissements avec indulgence ? Qu’est-ce qui le justifierait ? L’âge des victimes attendues ? À quel âge les droits de l’homme sont-ils caducs ? Une sorte de passe-droit accordé par un jury qui, les yeux perdus dans le lointain, se repasse le film de ses premières fois ?
Imaginez l’un de ces jeunes. Il fait la fête. Ou il essaye : c’est ça, faire la fête. Si le virus n’existe pas, rien à dire. Ce que nous avons tous connu ou, si nous ne l’avons pas connu, ce que nous avons tous désiré. Avec le virus, changement de pied et de musique. Même si sa conscience est en pâte de guimauve, il sent bien que le jeu n’est plus du tout innocent. Et que, dans cette affaire, les autres, le groupe, la meute, la chose qui braille, tout cela n’a qu’une idée : jeter un voile sur la réalité, un voile, songera-t-il peut-être, parfaitement autorisé celui-là, et même conseillé. La fête, si désirable, quelle certitude de tout oublier ! Mais il n’oublie rien du tout et en enrage. Le plus vrai de lui, ce n’est pas la fête. Le plus vrai de lui, ce n’est pas d’y renoncer. Le plus vrai de lui se cache dans son hésitation, tout à la fois dans son désir et dans l’impossibilité où il se sent de l’accepter. La question qu’il se pose, au fond, n’est pas celle de la fête. D’ailleurs aucune question ne se pose. Une vibration, un courant d’air, voilà tout. Désir. Fureur de le sentir incertain, bancal. C’est là qu’arrive sur l’écran la poêlée de compréhension que lui tendent des gens qui, quand tout va bien, jacassent solidarité ou pépient vivre ensemble. Bien aimables. Mais trop c’est trop, ils ne sont plus crédibles. Ce point d’affrontement, en lui, cette possibilité de rupture – détestable, franchement détestable, mais inaliénable -, voilà ce qu’ils sont en train de lui sucrer. C’est très déplaisant, ni sa fierté ni son orgueil ne peuvent s’y résoudre . Ça lui semble même franchement dégueulasse parce que, ce point-là, quelque chose lui souffle soudain qu’il est précieux. Bien sûr qu’ils veulent l’arranger, ces baveux ! Mais, pour l’arranger, ils le nient, ils le bousillent. Va-t-il vraiment s’en apercevoir ? Probablement. Et en tirer les conséquences ? Certainement pas. Devant quelle montagne de refus se retrouverait-il, le pauvre gars ! Gros à parier qu’il va foncer dans la fête et qu’il s’étonnera de s’y noyer comme jamais, sans chercher à savoir ce qu’il veut oublier quand il la gâche. Mais quoi ! La manœuvre a réussi. L’objectif est atteint. Notre jeune est cassé. Il est foutu. Il n’y a plus qu’à récupérer en lui ce qu’il a de plus laid et de plus bête et le badigeonner de vivre ensemble pour en faire un citoyen-consommateur exemplaire, un parfait petit agent de la honte. Nos services s’en chargeront. La République est sauvée. Et peut-être même l’élection.
J’entends parler avec beaucoup d’intérêt de projets pour le grand âge. Excellent. Mais il ne faut pas que l’avenir nous écarte du présent. Pas seulement parce que les projets pour le grand âge n’ont d’intérêt que s’il en reste encore quelques représentants. Surtout parce que la question actuellement posée à la jeunesse et, indirectement, à la vieillesse, engage l’avenir comme ne l’a jamais fait aucune disposition, comme ne le fera jamais aucun plan : il s’agit de savoir quel sens peut encore avoir la vie quand elle endosse la casaque de la mort, quand elle joue à et en même temps avec la mort. Il y a des débats que cet en même temps peut éclairer et d’autres pour lesquels il constitue une vilaine imposture : c’est le cas à chaque fois qu’il s’agit de l’être humain en tant que tel. Je n’effacerai rien de ce que j’ai écrit et garderai sur ce site la trace de mon enthousiasme après l’intervention d’Emmanuel Macron, peu après son élection, à la Halle Freyssinet. Mais je n’ai pas lu Berque assez attentivement. Désespérément naïf, j’ai pris pour la conviction fondamentale du président, pour un cri de son cœur, pour un reflet de son âme ce qui n’était qu’une de ses sortes – et Dieu ne sait que trop combien un jeune bourgeois bien doué et un peu greffé de jésuitisme peut en avoir, des sortes ! À la Solo, on en avait moins. Désolé, comme on dit aujourd’hui quand on ne l’est pas trop.
Je ne romps pas l’unité nationale mais je la consolide quand je demande que les pouvoirs publics veillent scrupuleusement et minutieusement à ce que les dispositions qu’ils prennent pour protéger la population soient appliquées par tous et par toutes et, d’abord, par la catégorie qui les respecte les moins, celle des 20-30 ans. L’unité nationale, ce n’est pas d’ouvrir à la jeunesse un océan d’irresponsabilité et un avenir de remords. Je demande que rien ne soit négligé des avertissements et des sanctions sans lesquels ces dispositions relèveraient de la farce. Et je souhaite que les femmes et les hommes de plus de 65 ans, qui ont déjà souffert plus que d’autres de cette crise – et pas seulement à cause de la malveillance du virus – s’accordent à penser qu’un pouvoir qui trouverait quelque détestable raison de ne pas les protéger autant qu’il le peut – je veux dire aussi fermement qu’il le faudra – ne mériterait certainement pas d’être reconduit à la prochaine élection.
.
La mémoire de l’avenir… Une des plus belles pages de Péguy, l’une de ces intuitions prophétiques où le passé et l’avenir coulent ensemble vers leur destin commun, avait tout prévu et tout annoncé. La formidable régression que la modernité a infligée à la conscience des pauvres comme à celle des riches a dénudé, du fait de l’épidémie, une violence élémentaire jusque-là à peu près maîtrisée. À bon droit, elle nous inquiète, nous effraie et, parfois, nous épouvante. Rien pourtant n’est désespéré. Ces quelques lignes de Péguy, tirées de L’Argent (suite), proposent l’avenir en décrivant le passé. On ne leur sera pas fidèle et l’on n’exhibera guère qu’une pleutre rouerie si l’on y voit une sorte d’incantation qu’on se fera gloire de ne pas prendre à la lettre. Il s’agit, à mes yeux, d’un rappel solennel, d’un dernier avertissement. Avec, dans la dernière phrase, un petit signe amical à l’homme politique qui aura le mieux compris : « La pensée antique ne se fût point insérée dans le monde, et elle n’eût point commandé la pensée de tout le monde si le soldat romain n’eût point procédé à cette insertion temporelle, si le soldat romain n’eût point mesuré la terre, si le monde romain n’eût point procédé à cette sorte de greffe unique au monde, unique dans l’histoire du monde, où Rome fournit la force et les Grecs la pensée, où Rome fournit l’empire et les Grecs l’idée, où Rome fournit la terre et les Grecs le point de source, où Rome fournit la matière et le temporel et les Grecs le spirituel et même ce que l’on pourrait nommer la matière spirituelle. Où Rome fournit le sauvageon et les Grecs le point de culture. »
Je plains de tout mon cœur les gens que ce texte ne touchera pas. Je plains de tout mon cœur ceux qu’il ne sortira pas d’eux-mêmes. Je plains de tout mon cœur ceux qu’il ne fera pas renoncer sur-le-champ à ces manœuvres de division – les uns contre les autres, les unes contre les uns – dont les arrière-pensées ne sont pas pacifiques. Je plains de tout mon cœur les ricaneurs. Je plains de tout mon cœur ceux qui se sont faits les esclaves d’une idole mille fois repeinte, mille fois grimée, mille fois déguisée qu’ils appellent toujours réalité. Je plains de tout mon cœur ceux que ce texte ne blessera pas, ceux en qui il n’ouvrira pas une brèche par où déferleront des océans d’inquiétude. Je plains de tout mon cœur les scrupuleux qui s’en imagineront exclus par leurs erreurs ou par leurs fautes. Je plains de tout mon cœur ceux qui se croiront trop grands pour lui. Je plains de tout mon cœur ceux qui se croiront trop petits pour lui. Je plains de tout mon cœur ceux qui ne saisiront pas la main qu’il nous tend. Je plains de tout mon cœur ceux à qui il ne donnera pas envie de ce qu’ils ignorent. Je plains de tout mon cœur ceux qui ne s’avoueront pas cette envie. Je plains de tout mon cœur ceux que ces quelques lignes ne mettront pas en déséquilibre.
Je ne rêve pas. Ce sont ceux qui vocifèrent qui rêvent. Ceux qui divisent et sectorisent. Il est bien vrai que les remuants sauvageons, assommants mais pas toujours antipathiques, ne représentent que l’aspect le moins grave de la question. Il est bien vrai que des crimes atroces sont commis qui n’ont rien à voir avec leur désordre. Mais attention. Nous n’avons pas affaire au problème des banlieues. Nous n’avons pas affaire au problème des territoires. Nous n’avons pas affaire à un problème de vocabulaire. Ce que nous voyons dans les banlieues et les territoires, c’est l’aspect, la tournure, l’allure qu’y prend un problème général, un problème national, un problème de civilisation (ou de décivilisation). Et quand une jeune fille, par ailleurs sans doute fort aimable et policée, explique avec un tel cynisme que les étudiants, quoi qu’il arrive, vivront leur vie d’étudiants et donc prendront des risques qu’ils transmettront, multipliés par dix ou par cent, à des gens plus fragiles qu’eux et qui, eux, en mourront, cette indifférence civilisée à la mort d’autrui, cette exécution souriante de son prochain au nom de son confort, dont je ne peux pas imaginer, sauf à faire de cette fille une machine ou un robot, qu’elle n’ait pas conscience, c’est l’aspect, la tournure, l’allure que prend le même problème général, le même problème national, le même problème de civilisation (ou de décivilisation) chez les plus favorisés ou moins défavorisés.
Il serait étrange que ceux qui combattent non sans raison le séparatisme agissent eux-mêmes comme des séparateurs. Se servir de crimes odieux pour truquer la réalité de l’immense problème qui nous défie, c’est aussi bête que pervers. On ne veut rien comprendre à la situation actuelle quand on refuse d’admettre que ce sont les mêmes causes qui, chez des jeunes de milieux si discordants qu’ils semblent étrangers les uns aux autres, produisent des effets différents. Et pourtant le cynisme et la violence sont frère et sœur. Chacun d’eux, demain, peut conduire à l’autre. Effrayante, cette jeunesse écartée de tout et dont on entretient la frustration. Effrayante, cette jeunesse protégée par des faibles et qui ne cesse de cultiver son égoïsme. Peu importe si l’histoire de chacun de nous le fait plus sensible au sort de l’une ou de l’autre : il faut les sauver ensemble, elles ne peuvent être sauvées qu’ensemble. Toutes deux sont en danger et toutes deux sont dangereuses, mais aucune des deux n’est condamnée. Dans l’une et dans l’autre veille ou somnole une énorme réserve de générosité qu’il s’agit de ne pas laisser pourrir.
Ce que les jeunes, sans trop le savoir, regardent dans les vieux ? L’avenir de leur jeunesse. Ils cherchent en eux ce qu’elle devient, comment elle évolue. Le reste, ils s’en foutent. Chers adultes, mes enfants, pas la peine de vous fatiguer à vous inventer des rôles, des personnages, de l’importance. Les jeunes observent en vous ce sur quoi vous n’avez aucune prise, ce qui annule vos leçons de morale, vos leçons de morale sévère comme vos leçons de morale compréhensive, toutes vos leçons, tous vos conseils, sans compter votre expérience, votre sagesse, vos confidences, et même vos cadeaux qu’un bref merci périme. Comprenez-les bien. Ce dont on profite, ou ce dont on voudrait profiter, on le hait. Ce monde, les jeunes le haïssent. Les uns – les pauvres – en braillant et en lui tapant dessus. Les autres – les riches – en le sabotant hypocritement au nom de leur intérêt. Cependant, ils s’appellent tous un peu Diogène, les jeunes. Ils traînent avec eux une grande boîte plus ou moins virtuelle dans laquelle ils précipitent consciencieusement les adultes qui ne font pas le poids – ou veulent trop le faire.
19 septembre 2020
Notes:
- De cette affaire, personne, semble-t-il, n’a plus entendu parler. Quelqu’un m’a vivement intéressé en émettant l’hypothèse d’une comédie, d’une farce dont la prétendue victime ne serait que l’un des protagonistes. Puisse cet optimiste avoir raison. Mimer la violence, c’est la dépasser, renoncer à elle sans renoncer à la protestation qui la fonde. Quelle merveille si la jeunesse était capable de cela – ou, du moins, quelques jeunes! Surréalistes, êtes-vous là? ↩